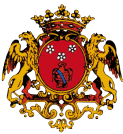Après une présentation des états de la langue égyptienne et des systèmes permettant de l’écrire nous verrons les dates clés du déchiffrement. Nous suivrons alors Champollion dans sa « Lettre à Monsieur Dacier » où il présente, pas à pas, le cheminement qui lui a permis de découvrir l’alphabet utilisé par les anciens égyptiens pour écrire les noms étrangers. Nous poursuivrons par sa découverte de la complexité du système et nous terminerons par une brève présentation de ce système.
[ Lire la suite ]

La dynastie Carnot et la Côte-d’Or
La famille Carnot fait partie des « dynasties républicaines », ces familles qui ont servi la République sur plusieurs générations. Originaire de Saint-Romain, elle s’établit au 17e s. à Nolay où elle acquit par la suite une charge de notaire. Le plus illustre des Carnot, Lazare, surnommé « Le Grand Carnot » ou « L’Organisateur de la Victoire », est né dans cette ville en 1753. [ Lire la suite ]
La tuberculose bovine en Côte-d’Or : un nouveau défi pour une maladie que l’on croyait ancienne.
La tuberculose est un fléau de l’Humanité partagé avec le monde animal.
Ainsi la tuberculose bovine est une maladie combattue collectivement depuis le 20e siècle pour limiter les risques de transmission à l’Homme et diminuer l’impact de cette maladie chez les bovins. À la différence de la lutte fondée sur la vaccination chez l’Homme, la lutte en santé animale s’appuie d’abord sur le dépistage et l’assainissement des foyers dépistés. Cette lutte menée par l’État pendant plusieurs décennies en partenariat avec les éleveurs, organisés en groupements de défense sanitaire -GDS-, et les vétérinaires, a fini par porter ses fruits. La France, comme la Côte d’Or, ont été reconnues indemnes de tuberculose bovine en 2001. [ Lire la suite ]
Vie et mort du majorat durant le Premier Empire : l’exemple de la Côte-d’Or
En mars 1808, l’Empereur Napoléon, secondé par l’archichancelier de l’Empire, Cambacérès, rétablit les titres, qui peuvent être transmissibles sous certaines conditions, et instaure, par ailleurs, un régime dérogatoire au droit commun de la transmission égalitaire du patrimoine, le majorat. Celui-ci devait répondre, lors sa formation et de sa transmission, à des formalités juridiques et administratives complexes, ressortant de la compétence du tout nouveau Conseil du sceau des titres. [ Lire la suite ]
Le château de Sainte-Colombe-en-Auxois, un passé, un avenir : de Jacques Filsjean à l’« ARCADE design à la campagne »
Il y a quarante ans tout juste, en 1979, l’état préoccupant du château de Sainte-Colombe-en-Auxois (portail à bossage disparu, toitures en passoires, élevage de veaux devant les dernières boiseries du XVIIIe siècle et de lapins sur les planchers à la française…) avait justifié, dans la crainte de sa disparition, l’engagement de recherches dont les résultats furent présentés en 1987 devant l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon (Commission des Antiquités). Elles mettaient en évidence l’originalité de son histoire (construction au milieu du XVIIe siècle par Jacques Filsjean sur un domaine récemment constitué) et la qualité de son architecture. [ Lire la suite ]
Morts pour la France à l’hôpital d’Alise-Sainte-Reine : surprenant oubli, hommage rédempteur
Sans avoir alors connaissance des travaux de Béatrix Pau, l’association Desnoyers-Blondel, constituée depuis 1992 pour servir le patrimoine matériel et immatériel de l’hôpital d’Alise-Sainte-Reine, s’est émue du traitement des dépouilles des soldats qui y décédèrent entre septembre 1914 et septembre 1919. Pourquoi une seule tombe délabrée dans le cimetière de l’hospice ? Combien de soldats pris en charge ? Pour quels maux ? Combien de décès, combien reconnus Morts pour la France ? Que sont devenues leurs dépouilles ? [ Lire la suite ]
Une forme méconnue de l’assistance à Dijon au 18e siècle : les ateliers de charité
La vogue des ateliers de charité traverse la fin du 18e siècle. Consistant à donner un revenu aux plus démunis des habitants d’une ville ou d’une communauté en contrepartie de travaux publics d’intérêt général, ils ont représenté, notamment pour Turgot, un moyen privilégié d’assurer une forme d’assistance aux pauvres valides, évitant le don de secours gratuits supposés encourager la paresse. Dans l’esprit de l’économiste et de ses amis, les ateliers avaient le double intérêt de créer du travail et de permettre théoriquement à tous de faire face à l’augmentation des prix des grains consécutive à la libéralisation introduite dans les années 1760. Dans plusieurs provinces (Champagne, Dauphiné, Limousin…), les ateliers de charité mobilisèrent d’importants moyens et se multiplièrent. Ailleurs (Bretagne, Bourgogne,…), ils restèrent peu utilisés. L’abbé Terray incita dès 1770 les Élus des États de Bourgogne à les mettre en place, mais il ne semble pas avoir été écouté. En 1774-1775, lors de libéralisation du commerce des grains consécutive à l’édit du 13 septembre 1774, Turgot fit de nouveau appel aux Élus qui créèrent plusieurs ateliers dans la province, puis dans sa capitale après l’émeute du 18 avril 1775. Toutefois, nous ne possédons que peu de détails sur le fonctionnement, le coût précis et la durée de ces ateliers, qui ne semblent pas avoir été maintenus au-delà de l’été 1775. [ Lire la suite ]
Un site d’élevage de lapins du Moyen-Âge dans le Val-Suzon : les garennes de Sainte-Foy
Depuis 2015, des recherches pluridisciplinaires, mêlant histoire, archéologie et sciences de l’environnement, sont menées dans le Val-Suzon afin de retracer l’histoire de ce territoire. De nombreux vestiges archéologiques préservés par la forêt ont ainsi été découverts.
C’est le cas, notamment, de mystérieuses structures situées à proximité du hameau de Sainte-Foy, qui se sont révélées être des garennes à lapins. [ Lire la suite ]
Modification des surfaces de matériaux avec des groupes organiques et dégradation de polluants organiques persistants par voie électrochimique
Au cours de ma communication je vais tout d‘abord montrer le rôle de l‘électrochimie dans le revêtement des surfaces de matériaux par des molécules organiques qui permet d’améliorer leur résistance vis-à-vis de leur environnement ou de les utiliser dans le domaine de l‘électronique moléculaire, de capteurs, du biomédical, de la catalyse ou du stockage de l‘énergie. Je montrerai également l‘importance du processus électrochimique dans la dégradation totale de polluants organiques tels que : pesticides, médicaments ou autres molécules organiques de synthèse. [ Lire la suite ]
Quel avenir pour la femme française après le 11 novembre 1918
La guerre a détruit 10% de la population, spécialement des hommes jeunes.
Pendant le conflit, les femmes ont assumé alors des responsabilités nouvelles dans tous les secteurs : elles ont pris la place des combattants et acquit une expérience.
Après le 11 novembre 1918, elles sont renvoyées sans ménagement dans leur foyer pour repeupler la France. Une politique nataliste avec deux lois en 1920 et 1923 est instituée pour redresser une démographie défaillante.
Mais les femmes ont pris conscience de leur rôle social pendant la guerre et leur comportement changé : elles contestent. Certaines se marient, d’autres font des études pour avoir un métier. [ Lire la suite ]
Des objets au corps connecté. Une démarche qui doit viser le meilleur en évitant le pire
Certains objets en se connectant grâce au numérique nous offrent de larges possibilités d’amélioration de nos conditions de vie en termes d’information, de communication, de contrôle de l’environnement, de transport, mais aussi en termes de santé.
C’est sur ce point que d’importantes questions éthiques commencent à se poser avec acuité.
Comment nous protéger d’une forme d’espionnage permise par l’extraordinaire évolution technologique qui a logiquement devancé la mise en place des moyens de contrôle et de sauvegarde vis-à-vis des risques de l’internet des objets ?
Comment permettre que notre corps, à son tour connecté, ne soit pas réparé pour le meilleur, mais augmenté pour le pire ?
C’est à ces questions que Jean-Pierre DIDIER Professeur émérite de l’Université de Bourgogne Franche-Comté se propose d’apporter des éléments de réponse lors de son discours de réception comme membre résidant de l’Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon.
Les monuments funéraires des églises dijonnaises, vestiges témoins d’un passé disparu
François Ier se serait exclamé en arrivant à Dijon : « Quelle belle ville, c’est la ville aux cent clochers ».
A la veille de la Révolution, Dijon compte effectivement plus de quarante édifices religieux : églises, monastères d’hommes et de femmes, hospices divers, établissements d’enseignement.
La majorité d’entre eux sont richement décorés ; de très nombreuses chapelles privées y sont fondées et abritent la sépulture de nobles familles ou de riches bourgeois. Ces derniers n’hésitent pas à passer commande auprès de talentueux artistes de monuments funéraires d’aspect fort varié, véritables chefs-d’œuvre pour certains. [ Lire la suite ]
Origine et naissance de la sécurité sociale
L’ordonnance du 4 octobre 1945 a créé la Sécurité sociale avec l’ambition d’offrir à l’ensemble des Français un système complet et obligatoire de protection. La population allait pouvoir bénéficier de l’Assurance Maladie, de l’Assurance Vieillesse, de l’Assurance Accidents du travail et des prestations familiales. Avant 1945, plusieurs textes assuraient déjà une protection mais à quelques catégories professionnelles seulement, système incomplet et sans unité : ainsi, une loi de 1898 avait octroyé une couverture contre les accidents du travail mais uniquement aux ouvriers de l’industrie. En 1930, après plusieurs échecs, le législateur avait fini par imposer pour les salariés du commerce et de l’industrie (les fonctionnaires avaient déjà droit à une retraite depuis Napoléon III, 1853, les Assurances Sociales (maladie et Vieillesse) puis en 1932, les Allocations familiales.
Gustave Eiffel : Rencontres avec les savants bourguignons et défis techniques de la construction de la Tour Eiffel
A l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, un concours fut ouvert pour la construction d’une tour de 1000 pieds de haut. Nouguier et Koechlin ont préparé un projet que Gustave Eiffel jugea très réaliste. Il a donc racheté tous les droits à ses deux ingénieurs et a proposé d’assurer la construction, puis le démantèlement, de la Tour avec ses fonds propres à condition d’avoir l’exclusivité de l’exploitation de l’édifice pendant 20 ans. [ Lire la suite ]
Un humble fils de paysan, Diogène Maillart (1840-1926), peintre parisien
Fils d’un père lettré et marchand de bestiaux, lui et ses frères fréquentèrent l’École des Beaux-Arts de Paris. Les dons artistiques de Diogène étaient certains mais aller étudier à Paris a été un problème. Et, de là, comment espérer être admis à la grande École ? Et devenir un jour artiste ? Cela fut pour lui un périple des plus ardus. [ Lire la suite ]