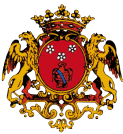L’édition 2021 du baccalauréat révèle un taux de réussite de 93%. La moitié des élèves entrant en 6e ne maîtrise pas la lecture. Ces chiffres officiels communiqués par le ministère de l’Éducation nationale ont provoqué mon ire, d’où l’idée de consacrer mon discours de réception à la déliquescence de notre système scolaire et de le mettre sous le titre volontairement provocateur : « Pavane pour une école défunte ». Chemin faisant, c‘est une remise en question de notre société qui se trouve abordée.