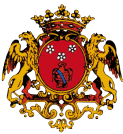L’œuvre et la personnalité de Lucie Randoin restent méconnues. Longtemps oubliée, au point que la photographie d’une autre illustrait ses notices, la figure de cette biologiste et nutritionniste bourguignonne vient d’apparaître au public avec l’émission d’un timbre-poste à son effigie. En 2023, la Bourgogne a attaché son nom à la première année de médecine instituée à Auxerre par l’Université de Bourgogne, et à la rue principale de son village natal, Bœurs-en-Othe (Yonne), en présence de la présidente de la Délégation sénatoriale aux droits des femmes et de représentantes du CNRS (INSB) et de sociétés scientifiques que L. Randoin avait animées (SSHA, SFBBM), et d’un vice-président de l’Université de Bourgogne. La conférence proposera, à partir d’archives souvent inédites, une synthèse du colloque tenu à l’Académie nationale de médecine (octobre 2024) et du chantier de recherche en cours sur le parcours institutionnel et les réseaux de cette animatrice et directrice de recherche, sur ses ambitions et stratégies personnelles et collectives en vue de développer la physiologie expérimentale de la nutrition, puis de faire reconnaître un enseignement technique supérieur féminin pour asseoir les sciences de la nutrition dans l’espace public. Dans l’ombre de l’imposante figure de Marie Curie – double Prix Nobel de physique (1903) et de chimie (1911) – à laquelle elle a succédé à l’Académie de médecine, L. Randoin appartient donc à la cohorte des pionnières qui ont ouvert les portes des bastions académiques aux femmes diplômées de l’Université. Lauréate de l’Académie des sciences en 1919 pour sa thèse préparée au Laboratoire de physiologie de la Sorbonne, dont elle a dirigé les travaux en l’absence des hommes mobilisés, elle orienta ensuite ses recherches sur les vitamines, établissant la « loi de l’équilibre alimentaire » (1923), militant pour un enseignement de la diététique et marquant l’histoire des sciences de la nutrition en France par ses recherches innovantes et par son expertise déployée en direction de l’industrie et de la puissance publique, à la tête de laboratoires de physiologie expérimentale de la nutrition, du ministère de l’Agriculture et de l’EPHE établi à l’Institut scientifique d’hygiène alimentaire (ISHA), puis du CNRS, jouant un rôle moteur dans l’Entre-deux-guerres au sein de la Société scientifique d’hygiène alimentaire et de la Société de chimie biologique, qu’elle a présidée à la suite de Gabriel Bertrand, de l’Institut Pasteur, l’un de ses appuis fidèles. Représentant la France dans de nombreux congrès internationaux (Conférences internationales pour la standardisation des vitamines, Congrès internationaux d’agriculture, etc.), elle prit aussi la direction de trois nouveaux services de l’ISHA, les Enquêtes nationales sur l’alimentation (1937), le Laboratoire de physiologie de la nutrition du CNRS, et l’Institut supérieur de l’alimentation (1938), prélude à la fondation de l’École de diététique de Paris (1951) et d’un diplôme national ayant donné naissance à un nouveau corps professionnel.