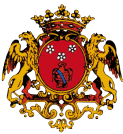L’étude du recrutement des évêques au Moyen-Âge a connu un essor important depuis les années 1960. L’historiographie des élites ecclésiastiques se divise ainsi en deux branches : l’approche institutionnel et l’environnement social. Une autre piste est à prendre en compte : celle du recrutement du « personnel ecclésiastique », et notamment celles des évêques et de leurs collèges de chanoines. Cela passe par des notices biographiques qui conduisent désormais cette étude vers l’histoire sociale et donc au développement de la prosopographie. Le diocèse de Langres n’échappe évidemment pas à cette tendance. Les biographies, en tant que telles, d’un évêque de Langres, aux Xe-XIIIe siècles, se réduisent à des portions congrues, notamment à travers les travaux généalogiques des dynasties auxquelles ils appartiennent. Le cas de Vilain d’Aigremont permet de renouveler cette approche biographique superficielle en s’intéressant à un cas unique : issu d’un lignage de chevaliers castraux, il bénéficie de la protection de Robert de Bourgogne, évêque de Langres, pendant que le château de Choiseul, nouvellement entré dans le patrimoine familial, passait sous domination épiscopal. Il y fera toute sa carrière : chanoine en 1084, puis diacre, archidiacre du Dijonnais, doyen, pour finir par être élu au siège épiscopal en 1125. C’est la première partie de cette carrière qui fait l’objet de cette communication.